
Une des plus habiles trouvailles de Howard Phillips Lovecraft consiste en un système de références internes, mélangeant fiction et détails authentiques, dont la répétition d’un texte à l’autre brouille les repères et induit un effet de réel et une familiarité qui semblent valider par contamination le reste de l’histoire. La fameuse bibliothèque de grimoires maudits dote le récit d’une assise, sinon solide, du moins troublante.

En fait, le résultat est tellement concluant qu’il s’est propagé plus loin que Lovecraft ne l’avait prévu, pour contaminer, au travers des textes, l’auteur lui-même. Si l’on se met à croire, même un tout petit peu, au Necronomicon, la tentation est grande d’attribuer à Lovecraft une érudition occulte, puis un statut d’initié à des réalités effroyables. En fiction, ce concept se solde souvent par une fausse bonne idée typique: «Je vais raconter la vie qu’aurait connue Lovecraft, si le Necronomicon, Cthulhu et Nyarlathotep existaient pour de bon!» Depuis quelque temps, les fictions autour de Lovecraft se multiplient et trop de scénaristes se ruent sur cette trouvaille paresseuse comme la misère sur le pauvre monde. Et nous valent une palanquée de «biographies» répétitives, où Lovecraft, Necronomicon sous le bras et lueur hallucinée dans les prunelles, lutte pour empêcher Cthulhu de débarquer à Providence à l’heure du dîner.
Aux marges de ce sous-sous-genre, recommandons au passage un excellent roman de Richard Lupoff, Marblehead, qui tisse une magnifique fiction à partir d’éléments plus réalistes, voire historiques, et avec un résultat autrement plus original.

Alors que paraît ce qui s’annonce pour un moment comme la biographie définitive de HPL, I am Providence par S.T. Joshi (la version intégrale de la biographie déjà parue il y a quelque quinze ans sous le titre Lovecraft: a life, rétablissant quinze mille mots de manuscrit amputés à l’époque, le tout remis à jour, sous forme de deux volumes assez ventrus), plusieurs bandes dessinées traînent la vie de Lovecraft dans la fiction, avec des résultats inégalement satisfaisants.
En voici trois exemples assez marquants.
 Le Lovecraft de Hans Rodionoff, Enrique Breccia et Keith Giffen, sorti chez Vertigo en 2003, jouit d’un dessin nerveux, baroque et coloré, riche d’une belle ambiance onirique. Enfermé dans l’asile où il va mourir fou, le père du petit Lovecraft veut que ce dernier lise un ouvrage qu’il a compilé, chargé de redoutables connaissances occultes. Hanté par des rêves tentateurs, harcelé par des créatures effroyables, prisonnier de ce secret qu’il doit tenir à l’écart du monde, l’enfant grandira et vivra en marge de l’humanité.
Le Lovecraft de Hans Rodionoff, Enrique Breccia et Keith Giffen, sorti chez Vertigo en 2003, jouit d’un dessin nerveux, baroque et coloré, riche d’une belle ambiance onirique. Enfermé dans l’asile où il va mourir fou, le père du petit Lovecraft veut que ce dernier lise un ouvrage qu’il a compilé, chargé de redoutables connaissances occultes. Hanté par des rêves tentateurs, harcelé par des créatures effroyables, prisonnier de ce secret qu’il doit tenir à l’écart du monde, l’enfant grandira et vivra en marge de l’humanité.
En fait, le scénario est l’adaptation en bédé par Keith Giffen d’un script pour le cinéma de Rodionoff. Que dire, sinon que le scénariste enfile les clichés avec une belle santé, à défaut de beaucoup de cohérence? On nous montre ainsi le petit Lovecraft à cinq ans habillé avec une robe et portant de longs cheveux. «Je suis une petite fille», affirme le mouflet. Détail biographique exact, en effet, mais dont on ne voit pas trop la pertinence ici. Est-ce pour nous montrer que la mère de Lovecraft est déjà bien barrée, la pôvre? Que Lovecraft va être durablement traumatisé par cette enfance anormale? C’est oublier un peu vite qu’à l’époque les enfants portaient couramment ce genre de tenue et les cheveux longs, indépendamment de leur sexe, jusqu’à un certain âge — sans doute une volonté de leur conférer un certain air angélique. Mais on ne voit pas bien, même avec la meilleure volonté freudienne, en quoi le fait d’être traité en poupée par sa maman aurait pu susciter chez Howard des fantasmes de monstres verruqueux et tentaculaires dans sa vie ultérieure. Surtout qu’on va nous montrer qu’il voudrait bien vivre normalement, le malheureux, mais que c’est les monstres qui font rien qu’à l’embêter.
Bref, ce détail figure ici uniquement pour son côté pittoresque. Folklore gratuit.

La chronologie des faits est sérieusement chamboulée: nous voyons Edwin Baird, rédacteur en chef de Weird Tales, rejeter «L’appel de Cthulhu» que lui soumet Lovecraft, mais lui suggérer aussitôt une collaboration plus lucrative avec Houdini (apparemment, HPL écrit des histoires trop bizarres pour Weird Tales, ce qui est un concept assez cocasse). Rappelons que cette collaboration avec le roi de l’évasion eut bien lieu, donnant la nouvelle «Prisonnier des Pharaons», qui date de 1924 alors que HPL écrit «Cthulhu» à son retour à Providence, en 1926, après l’échec de son mariage avec Sonia Greene… que Lovecraft rencontre ici en sortant du spectacle d’Houdini (une rencontre où Lovecraft est l’initié qui connaît l’invisible, face à Houdini, sot défenseur d’un matérialisme buté). Précisons que c’est à Farnsworth Wright, le successeur de Baird, que Lovecraft a dans la réalité soumis «Cthulhu», qu’il refusera dans un premier temps. Bref, une inextricable salade. Lorsque le cinéaste John Carpenter pontifie dans sa préface que tous les incidents décrits dans l’histoire sont absolument authentiques et que seules les motivations ont été romancées, il minimise sacrément les sévices infligés à la vérité historique.

Tout cela s’excuserait si le résultat était original: mais le principe de base de l’histoire est d’une grande banalité et ne débouche sur rien de très nouveau. Lovecraft voudrait connaître une vie tranquille, mais de vilains monstres suintent sans arrêt de l’autre réalité, charriant tous les noms et les personnages pour lesquels il sera connu. En plus d’être harcelé par un zoo invisible, HPL n’avait donc pas une once d’imagination: il se bornait à retranscrire sa vie quotidienne pour purger sa tête de toutes ces saletés. En effet, c’est tout de suite plus intéressant… Ce point forme d’ailleurs l’aspect le plus irritant des théories de l’initiation de Lovecraft à des connaissances occultes: elles le ravalent au rang de simple retranscripteur, lui déniant à des degrés variables un talent de créateur original.

Et quand notre scénariste s’aventure hors de sa macédoine de biographie, il écrit des scènes mille fois vues dans les téléfilms américains, comme celle où le jeune Lovecraft est harcelé par une bande de vilains chenapans qui mettent sa sexualité en doute et périssent horriblement démembrés par les créatures méphitiques qui hantent Lovecraft. L’équivalent hollywoodien de la classique scène de revanche proustienne.

 Même au niveau d’une hypothétique représentation métaphorique de la vie de Lovecraft, on barbote dans les clichés de l’individu hagard et halluciné qui ne réussit jamais à se purger de ses horreurs et de la crainte sourde d’une hérédité chargée d’une contamination obscure. Muré dans la misère et la solitude par son savoir terrible, il est condamné à tenter un vague exorcisme par la fiction, simple retranscription de l’indicible réalité qu’il est seul à connaître. Bref, la vie de Lovecraft est dépeinte à grands coups de clichés approximatifs. Les dessins, en revanche, sont vraiment superbes, exécutés avec verve et grotesque par la plume douée de Breccia.
Même au niveau d’une hypothétique représentation métaphorique de la vie de Lovecraft, on barbote dans les clichés de l’individu hagard et halluciné qui ne réussit jamais à se purger de ses horreurs et de la crainte sourde d’une hérédité chargée d’une contamination obscure. Muré dans la misère et la solitude par son savoir terrible, il est condamné à tenter un vague exorcisme par la fiction, simple retranscription de l’indicible réalité qu’il est seul à connaître. Bref, la vie de Lovecraft est dépeinte à grands coups de clichés approximatifs. Les dessins, en revanche, sont vraiment superbes, exécutés avec verve et grotesque par la plume douée de Breccia.
Sans doute handicapé par un scénario oubliable, l’album est sorti en français dans un silence indifférent.
*

En 2009, The Strange Adventures of H.P. Lovecraft de Mac Carter (scénario) et Tony Salmons (dessins) attaque très fort: la première couverture de la parution en fascicules promet d’emblée une version extrêmement désinvolte des aventures de l’écrivain. Howard, en bras de chemise, une belle coupe de cheveux sportive ornée d’une seyante mèche blanche façon Diaghilev, pianote de tous ses doigts déliés sur le clavier d’une machine à écrire d’où sourdent des monstruosités tentaculaires. Quand on sait que plusieurs textes de Lovecraft, dont L’affaire Charles Dexter Ward, n’ont jamais été soumis à un éditeur, tant l’idée de les mettre au propre à la machine à écrire révulsait l’écrivain, l’image ne manque pas de sel.
Et ne parlons même pas du revolver posé sur la table, à côté des balles.

 L’intérieur ne se gêne pas davantage. Lovecraft est un beau jeune homme solide, sportif et dynamique, qu’on imaginerait plutôt reporter dans un grand journal. Vivant chez ses deux adorables tantines, il est amoureux d’une charmante jeune femme, mais celle-ci est courtisée par un autre. Une nuit, Lovecraft s’effondre et, au matin, on retrouve son rival déchiqueté d’horrible façon. HPL comprend vite que, lorsqu’il s’endort, d’effroyables entités émergent de son subconscient pour semer la terreur à Providence; le sommeil de sa raison engendre des monstres, comme aurait diagnostiqué Goyá. Avant longtemps, HPL est recherché par la police et doit prouver son innocence, au long d’une enquête menée tambour battant.
L’intérieur ne se gêne pas davantage. Lovecraft est un beau jeune homme solide, sportif et dynamique, qu’on imaginerait plutôt reporter dans un grand journal. Vivant chez ses deux adorables tantines, il est amoureux d’une charmante jeune femme, mais celle-ci est courtisée par un autre. Une nuit, Lovecraft s’effondre et, au matin, on retrouve son rival déchiqueté d’horrible façon. HPL comprend vite que, lorsqu’il s’endort, d’effroyables entités émergent de son subconscient pour semer la terreur à Providence; le sommeil de sa raison engendre des monstres, comme aurait diagnostiqué Goyá. Avant longtemps, HPL est recherché par la police et doit prouver son innocence, au long d’une enquête menée tambour battant.

C’est peu dire qu’on navigue dans une version farfelue de la vie de Lovecraft; à vrai dire, on est tout surpris au détour d’une page, de tomber parfois sur des éléments de biographie authentiques! Pour le reste, on suit une intrigue amusante, pas débordante d’originalité, mais rondement menée. Toute ressemblance avec HPL est secondaire, voire fortuite, et la vie de l’auteur sert de tremplin initial, vite abandonné. Il y a peut-être même du second degré, bien que distillé en quantités extrêmement parcimonieuses. Nous sommes ici dans une inspiration purement pulps, déjantée quoique classique, qui a pour but de raconter une histoire mouvementée peuplée de créatures monstrueuses et de personnages archétypaux: Lovecraft est le vaillant héros; Farnsworth Wright, un éditeur froid et retors, ce qui contraste un peu avec le vrai Farnsworth Wright, célèbre pour son perpétuel tremblement qui en faisait le rédacteur en chef idéal d’une revue d’horreur! Les flics, corrompus et bovins, font fausse route dès le départ et traquent l’innocent… L’aventure s’achève sur le débarquement au Caire, où Indiana Lovecraft va mener une enquête sur ce damné Necronomicon et ce mystérieux rascal d’Abdul Alhazred qui l’a écrit. Il n’avale pas une rasade de whisky en enfonçant son chapeau sur sa tête d’un coup de poing, mais l’intention est là.
L’histoire distrait, dans les limites choisies du récit d’action horrifique. Signalons que les dessins intérieurs sont nettement plus relâchés que les couvertures, et que l’on sent la précipitation monter au fur et à mesure des épisodes, ce qui gâche un peu le plaisir.
*

Howard Lovecraft and the Frozen Kingdom, sorti en 2009 également, est sans doute le traitement de Lovecraft qui se tire le mieux de l’exercice, parce que c’est celui qui emploie le plus ouvertement l’humour: en mettant carrément en scène un Howard moutard de cinq ans plongé dans les vastitudes neigeuses de Leng et aidé par une entité tentaculaire dont l’aspect ne nous est pas totalement inconnu, Brown et Podesta court-circuitent le principe de la biographie, et font dérailler l’intrigue vers un genre de grande aventure de Calvin & Hobbes nappé de sauce HPL.



Et c’est plutôt réussi. Ce très jeune HPL — passablement canaille, de surcroît, comme les gamins de cinq ans peuvent l’être — vit ses aventures dans un contexte assez macabre et inquiétant qui colore la comédie farfelue d’une nuance originale. Les origines de Cthulhu ont même un léger ton de tragédie. Bref, c’est une distraction assumée comme telle et tout à fait agréable.
*

Avant de faire vivre à HPL des aventures qui louchent plus vers Dashiell Hammett ou Raymond Chandler que vers sa vie propre, l’éditeur Dark Horse avait soumis un autre auteur de bizarreries au même traitement de choc. Cette fois, il s’agissait de Charles Hoy Fort, auteur de Lo!, du Livre des Damnés et autres compilations de faits-divers inexplicables glanés dans la presse de son temps. Changé en aventurier du bizarre de la Belle Époque, armé d’un fusil de chasse et assisté par un médecin extra-terrestre, il traquait dans les égouts des créatures dotées de tentacules griffus.

Assez pince-sans-rire (voir la première page ci-dessus), l’histoire, parue en 2002, est rigolote mais maigrelette. Physiquement, Charles Fort ressemble beaucoup à Theodore Roosevelt, ce qui devient un peu gênant quand l’intrigue veut que leurs chemins se croisent. Notre héros enfonce virilement les portes à coups de pied et, secondé par un médecin amiboïde et un gamin des rues nommé H.P. Lovecraft (à New York en 1899? Tiens, tiens…), flingue avec une belle santé les monstres venus d’ailleurs, dans une intrigue qui tient tantôt des Men in Black, tantôt de proto-X-Files — ce qui se tient, Fort étant un peu l’aïeul de Mulder. Les dessins de Frazer Irving, dans un noir et blanc riche en hachures pour un bel effet de gravure sur bois, sont très esthétiques, mais les jeux de clair-obscur ne masquent pas toujours des soucis de perspective et d’anatomie.

Le scénario de Lenkov, mouvementé, n’est pas d’une lisibilité irréprochable (il faudra pratiquement attendre la fin pour avoir confirmation que la jeune femme qui aide Fort n’est pas son épouse, mais une assistante travaillant dans la même bibliothèque que notre héros. Et l’intrigue s’achève grâce à un coup de chance assez scandaleux). Toutefois, Charles Fort, dont l’œuvre a eu son heure de gloire au cours des années soixante-dix, semble être retombé dans l’obscurité, et l’originalité de la démarche mérite qu’on la signale. Le second degré sarcastique du ton aide beaucoup à faire passer le grand n’importe quoi des péripéties. On aurait quand même pu éviter de montrer Fort, à l’aube du 1er janvier 1900, en train de saluer un «XXe siècle naissant», mais ce genre de bourde est hélas communément répandu.

Une suggestion, pour conclure: faire vivre à un auteur des aventures qui préfigurent ses œuvres est un cliché qui devient de plus en plus couru et de plus en plus délicat à exécuter proprement. Il est grand temps de trouver une meilleure «bonne idée».
Conseil de lecteur.

 Comme à chaque fois, c’est l’occasion de me remettre en contact avec ma mémoire ancestrale, de déplacer et d’épousseter des piles de fanzines, de magazines et de livres que les mouvements complexes de la tectonique des empilements ont retiré à ma vue et à ma connaissance depuis longtemps. J’ai ainsi renoué avec une quantité invraisemblable de fanzines: je ne pensais pas avoir dessiné autant de couvertures pour Yellow Submarine; j’ai exhumé de nombreux numéros du catalogue de la mythique librairie Ailleurs, certains portant des couvertures plus ou moins réussies issues de ma plume, entre autres un Peter Pan dont j’ai toujours été assez content et ma première illustration de Gareth, un panda de sword & sorcery (1984!); et j’ai déterré une pile de Manticora (ici, c’est Philippe Ward qui clique J’aime), mais surtout des trois derniers numéros, alors que je cherchais le 6 et le 8 (ici, Philippe Ward clique sur Je n’aime plus).
Comme à chaque fois, c’est l’occasion de me remettre en contact avec ma mémoire ancestrale, de déplacer et d’épousseter des piles de fanzines, de magazines et de livres que les mouvements complexes de la tectonique des empilements ont retiré à ma vue et à ma connaissance depuis longtemps. J’ai ainsi renoué avec une quantité invraisemblable de fanzines: je ne pensais pas avoir dessiné autant de couvertures pour Yellow Submarine; j’ai exhumé de nombreux numéros du catalogue de la mythique librairie Ailleurs, certains portant des couvertures plus ou moins réussies issues de ma plume, entre autres un Peter Pan dont j’ai toujours été assez content et ma première illustration de Gareth, un panda de sword & sorcery (1984!); et j’ai déterré une pile de Manticora (ici, c’est Philippe Ward qui clique J’aime), mais surtout des trois derniers numéros, alors que je cherchais le 6 et le 8 (ici, Philippe Ward clique sur Je n’aime plus). J’ai ramené à la lumière du jour des fanzines finnois, photocopiés et imprimés, une pile de photos de vacances aux États-Unis (que je vais inspecter de près, quand j’aurai le temps), une boîte de diapos pour une conférence sur les mangas, le n°1 de Warrior (avec Axel Pressbutton et V for Vendetta), quelques exemplaires de Comics Unlimited, le fanzine d’Alan Austin, avec plein de dessins de Jean-Daniel Brèque, de John Bolton et d’autres, des Mangazone et des Scarce, une lettre de Bill Mantlo, deux ou trois romans ou recueils dont j’ignorais totalement que je les possédais, deux exemplaires de mon mini-fanzine Dõbutsuen qui ont de fortes chances de se voir affichés un de ces quatre matins sur mon autre blog, des mauvaises photocopies de vieilles bandes dessinées, plus ou moins collées ensemble, et des numéros du Bulletin du SFFAAN (orthographe non contractuelle) où était paru Mulberry Bloom, première bédé longue dont j’ai atteint le terme. Et dont je n’ai jamais récupéré les originaux…
J’ai ramené à la lumière du jour des fanzines finnois, photocopiés et imprimés, une pile de photos de vacances aux États-Unis (que je vais inspecter de près, quand j’aurai le temps), une boîte de diapos pour une conférence sur les mangas, le n°1 de Warrior (avec Axel Pressbutton et V for Vendetta), quelques exemplaires de Comics Unlimited, le fanzine d’Alan Austin, avec plein de dessins de Jean-Daniel Brèque, de John Bolton et d’autres, des Mangazone et des Scarce, une lettre de Bill Mantlo, deux ou trois romans ou recueils dont j’ignorais totalement que je les possédais, deux exemplaires de mon mini-fanzine Dõbutsuen qui ont de fortes chances de se voir affichés un de ces quatre matins sur mon autre blog, des mauvaises photocopies de vieilles bandes dessinées, plus ou moins collées ensemble, et des numéros du Bulletin du SFFAAN (orthographe non contractuelle) où était paru Mulberry Bloom, première bédé longue dont j’ai atteint le terme. Et dont je n’ai jamais récupéré les originaux…
























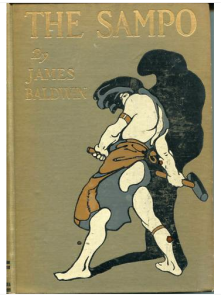

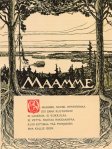
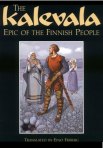


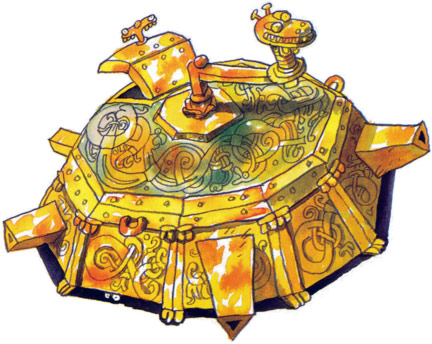



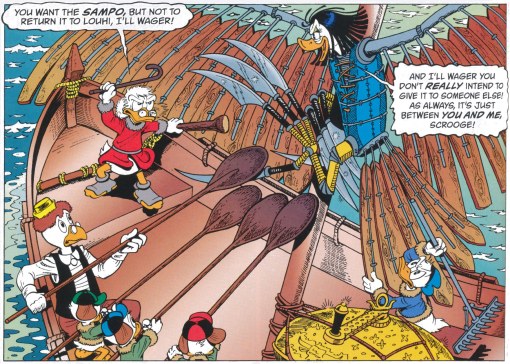


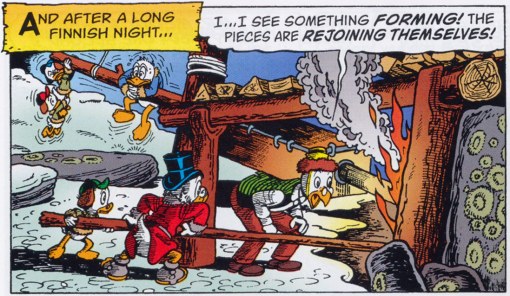


























 L’album précédent de Bryan Talbot était le formidable Alice in Sunderland, un somptueux délire de styles et de sujets tournant autour des relations, diverses et plus étroites qu’il ne semblerait, qu’entretenaient Lewis Carroll et la ville de Sunderland, au nord-est de l’Angleterre. Grandville est une nouvelle collision de genres et de citations, pour un résultat épatant et ébouriffant. Polar situé dans un monde steampunk d’animaux humanoïdes, sur une intrigue policière dont les ressorts ne sont pas si éloignés de notre monde, avec des clins d’œil visuels saupoudrés en bonus (une affiche vantant le spectacle d’Omaha la danseuse, une partie de cartes avec des chiens…), Grandville est une histoire d’action qui se fonde sur les anticipations de Robida et les dessins de Grandville, où l’on retrouve le goût de Talbot pour les architectures grandioses, réelles et imaginaires. Aux allusions visuelles répondent des trouvailles dans les noms et des jeux de mots assez discrets dans les dialogues (très british, mais censés être français, comme on le découvre vite).
L’album précédent de Bryan Talbot était le formidable Alice in Sunderland, un somptueux délire de styles et de sujets tournant autour des relations, diverses et plus étroites qu’il ne semblerait, qu’entretenaient Lewis Carroll et la ville de Sunderland, au nord-est de l’Angleterre. Grandville est une nouvelle collision de genres et de citations, pour un résultat épatant et ébouriffant. Polar situé dans un monde steampunk d’animaux humanoïdes, sur une intrigue policière dont les ressorts ne sont pas si éloignés de notre monde, avec des clins d’œil visuels saupoudrés en bonus (une affiche vantant le spectacle d’Omaha la danseuse, une partie de cartes avec des chiens…), Grandville est une histoire d’action qui se fonde sur les anticipations de Robida et les dessins de Grandville, où l’on retrouve le goût de Talbot pour les architectures grandioses, réelles et imaginaires. Aux allusions visuelles répondent des trouvailles dans les noms et des jeux de mots assez discrets dans les dialogues (très british, mais censés être français, comme on le découvre vite).





